Résistance Dunkerquoise réseau ALLIANCE
1-Origine du groupe « Alliance »
Il est créé en août 1940, deux mois après la défaite de la France.
À ce stade, la résistance est avant tout un ensemble d’initiatives diverses,
souvent individuelles, encore hésitantes. Dans ce contexte, le commandant
Georges Loustaunau-Lacau et Marie-Madeleine Fourcade ont l'idée de créer un
réseau de résistance chargé de transmettre des renseignements aux Britanniques
et aux Français Libres. Baptisé « Alliance », surnommé l’Arche de Noé par les
nazis parce que ses membres ont pour pseudonyme des noms d’animaux, ce réseau
est relié à l’Intelligence Service (services
secrets britanniques) en 1941.
En 1943, le réseau « Alliance » compte environ 3 000 membres dont un quart sont des femmes. Spécialisé dans le renseignement, le réseau organise aussi une filière d'évasion et d'exfiltration pour les aviateurs alliés abattus et tous ceux désireux de poursuivre le combat aux côtés des Alliés.
Extrait de struthof.fr
Un jour, au début du printemps 1941, une proposition était faite à la famille Herbeaux : participer à la collecte de renseignements militaires.
Après en avoir discuté et avoir pesé tous les risques, la famille décidait d'accepter. Louis Herbeaux allait collecter les informations avec sa fille, qui sachant quelque peu dessiner, reportait les renseignements traçait les plans ; quant à Mme Herbeaux, elle allait servir de "boîte à lettres" recevant les diverses informations. Les agents allaient être recrutés les uns parmi les relations amicales de la famille, d'autres parmi les relations professionnelles ; d'autres encore grâce au hasard ou aux fonctions qu'ils exerçaient dans divers organismes de de l'occupation.
Quinze personnes composaient ce groupe en octobre 1942, quelques semaines avant sa capture.
La plupart étaient jeunes sinon même très jeunes. Issus des milieux sociaux de la bourgeoisie petite et moyenne pour le plus grand nombre, ils étaient tous animés d'un patriotisme assez sourcilleux.
En fait, seuls les Allemands occupaient, restreignaient la liberté des Français, mutilaient le territoire : pas les Anglais. En outre, le désir de servir, de se rendre utiles, animait aussi ces jeunes gens qui voulaient vivre une période exaltante.
ils savaient ce qu'une capture leur réservait et avaient fait leur choix en toute connaissance de cause.
Le réseau dunkerquois, installé dans la zone rouge vivait dans une assez grande autonomie et n'avait de relations effectives qu'avec Paris où le chef n'était autre que le très jeune colonel d'aviation, Alamichel, un des principaux agents du réseau "Alliance", qui, fondé par le commandant Loustaunau-Lacau et Marie Madeleine Fourcade, dépendait de l'Intelligence Service.
Cependant, Louis Herbeaux et le secteur de Dunkerque avaient choisi de fournir aussi leurs informations au B.C.R.A. car ils estimaient que Français, ils avaient à informer De Gaulle plutôt que Churchill ; d'autre part, "gaullistes", ils n'approuvaient pas certaines méthodes adoptées par la "Centrale" et notamment l'appui à Giraud et certaines arrière-pensées trop politiciennes.
En tout cas, à l'automne 1942, la situation du réseau dunkerquois était devenue assez marginale. Il est probable que les remous provoqués par l'affaire Giraud aient été à l'origine des difficultés que le réseau nord d'"Alliance" connut au cours de l'automne 1942 et de l'hiver 1942-43 .
Cette situation autonome favorisa le choix de certaines méthodes personnelles. Alors qu" 'Alliance" constituait un réseau militaire, Louis Herbeaux avait laissé une assez large initiative à chacun de ses agents : chacun apportait les informations qu'il pouvait obtenir, étant entendu que tout était rassemblé et synthétisé au domicile du chef de secteur qui cachait les doubles de ses documents dans un pavillon de l'Hôpital de Dunkerque. Dans une clandestinité totale, chacun collectait ce qui pouvait être utile au service.
Les agents parvinrent à obtenir des renseignements fort intéressants, sur le central téléphonique de Dunkerque, emplacements de rampes de lancement des fusées allemandes V2, la base sous-marine, la fortification du littoral, et même l'installation de sous-marins. Des observations permirent de faire connaître des mouvements de troupes et de percer ainsi certaines manœuvres militaires allemandes. L'activité du groupe était assez riche et la sûreté de ses informations assez solide pour que la "Centrale" eût décidé de confier un poste émetteur qui aurait permis de communiquer à la fois avec Londres et Paris.
Enfin, une mission de préparation des terrains de parachutage dans la zone rouge lui avait été confiée :
Andréa Herbeaux aurait du partir pour l'Angleterre si elle n'avait pas été arrêtée en novembre 1942.
Arrestation pour les motifs variés qui amenaient d'ailleurs toujours ce genre de tragédie : une imprudence, une dénonciation. Cette arrestation se produisait à un moment difficile pour l'organisation "Alliance"qui avait eu à s'occuper du débarquement en Afrique du Nord et avait apporté son appui total au général Giraud.
L'Abwehr en avait profité pour lancer un vaste coup de filet qui avait permis de capturer pratiquement tout le réseau de la zone interdite et qui avait failli même aboutir à l'arrestation des chefs de la Centrale. En tout cas, entre le 1 3 et le 1 9 novembre, les principaux agents de Dunkerque étaient tous arrêtés : parmi eux, R. Bonpain, J . Lanery , L. Herbeaux, sa fille. Une longue instruction imposait une période de détention d'autant plus pénible que les interrogatoires se multipliaient : il fallait connaître l'importance du réseau et rassembler les fils menant aux chefs suprêmes.
Ce n'est que le 19 mars que les inculpés étaient présentés devant le tribunal militaire de Lille : sept condamnations à mort étaient prononcées: Herbeaux, Bonpain, Rousseau, Lanery, Bryckaert, Hus, Briois, Verrons ; pour les autres, c'était la déportation. Comme l'Abwher n'avait obtenu aucun renseignement solide sur l'activité du groupe au-delà de la zone interdite, le soir du jugement des Dunkerquois, elle relançait sa poursuite à Paris, pour atteindre les dirigeants.
Le jugement du tribunal militaire condamnait les inculpés reconnus coupables d'espionnage, à la peine normale en ce cas : la mort. Cependant, parmi ces condamnés, une certaine hiérarchie des responsabilités avait été établie.
Les sept condamnés à mort présentèrent un recours en grâce.
le 29 mars arrivait l'annonce du rejet du recours pour L. Herbeaux, J. Lanery, J. Rousseau, le Lillois, et R. Bonpain. Le 30 mars 1943 ils seront fusilliés au fort de Bondues.
Tous les membres du groupe "Alliance" avaient agi par patriotisme. Leur engagement individuel correspondait à un choix personnel.
Extrait de :Revue du Nord 1978 Robert Vandenbussche
3- composition du réseau "alliance" de Dunkerque
Andrée Herbeaux (Anchois)-
Suzanne Herbeaux (Lavarest)-
Pierre Lanery (ruban bleu)-
L'abbé Bonpain .(Eider-T100)-
Abbé Charles Lemaire (crave-T45)-
Pierre Briois (Brore)-
Paul Verrons-
FFC DIR
Armbouts-Cappel le 26/03/1904
Alexandre Hus-
Claude Burnod (nort)-
Jean Bryskaert
interprète à la Kriegsmarine
Il récupérera les plans complets de la base sous-marine
Dunkerque le 20/08/1922
Arrêté le 20/11/1942
Albert Sautiere
Irma Marin (Raiw)
les frères Drugmand






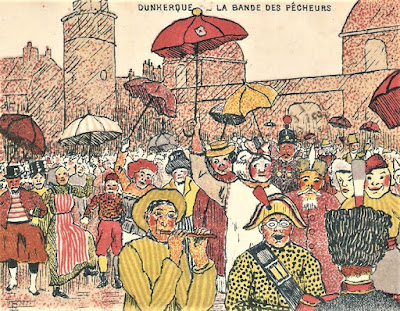
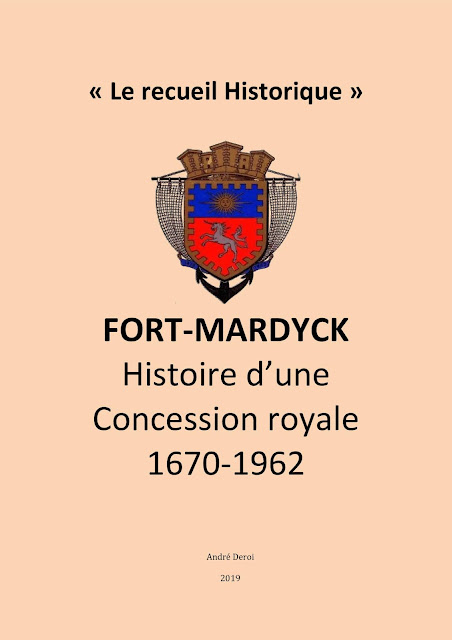





Commentaires