Dunkerque Les Jésuites 1600/1767
. De cette ville voisiné, les religieux pouvaient sans grande peine constater combien leur ministère serait, utile à Dunkerque
Les Jésuites estimèrent qu'il leur revenait de suppléer dans la mesure de leurs moyens à cette insuffisance de clergé. Aussi envoyèrent-ils chaque semaine quelques-uns de leurs pères dans le but d'enseigner aux enfants la doctrine chrétienne, et de visiter les hôpitaux et les prisons.
Leurs efforts furent rapidement couronnés de succès.
Leur enseignement du catéchisme fut bientôt suivi, non seulement par les enfants, mais par beaucoup d'adultes
Les prisons leur donnèrent, au début surtout, beaucoup de travail.
Des conférences furent faites à la garnison, non seulement aux soldats flamands, mais aussi aux espagnols.
Étonnés des succès obtenus par les religieux, les conseillers de l'Amirauté, leur prodiguèrent leurs encouragements.
En 1612 la paroisse de Dunkerque se trouvait sans desserviteur. Pendant quelques mois, par ordre de l'Evêque d'Ypres, ce furent encore les Jésuites qui eurent la charge de prêcher trois fois par semaine.
Leur Provincial, estima que l'occasion était propice pour créer à Dunkerque un établissement stable : Ce projet leur parut d'autan plus facile à réaliser, qu'en l'absence de curé, la Société pouvait se concilier les sympathies de la population et du corps municipal.
Ce qui l'y engageait surtout, c'est que la Société était déjà propriétaire d'un local. Car, peu d'années auparavant ( en 1609) le premier dunkerquois entré dans la Compagnie de Jésus avait fait don au collège de Bergues, de deux maisons assez spacieuses, placées dans le meilleur quartier de la ville, sous la réserve toutefois que si un jour la Société s'établissait à Dunkerque, ces bâtiments seraient affectés à la nouvelle résidence.
Ces deux maisons se trouvaient non loin de l'Hôtel de Ville, dans la rue qui s'appelait alors Oostpoort Straetje (Rue de la porte de l'Est).
Ce fut ainsi que le 16 Octobre 1612, le Père Provincial détacha du collège de Bergues2 frères pour résider définitivement à Dunkerque.
Il s'agissait de savoir en quel local les Pères pourraient officier ou confesser.
Leur Provincial n'admettait pas que ce fût dans un couvent de religieuses.
Il choisit la chapelle Sainte-Anne (dans l’église saint Eloi) qui était assez vaste et séparée du reste de l'église par une colonnade. Les Pères y placèrent un coffre dans lequel ils rangèrent leurs ornements et les objets nécessaires au culte.
A la suite de l'agrandissement de leur local, deux autres frères coadjuteurs et un troisième père vinrent s’ajouter aux premiers : La résidence comptait donc six personnes. Elle resta, cependant, rattachée au collège de Bergues.
Cette situation se prolongea tant que la résidence resta sous la dépendance du collège de Bergues, c'est-à-dire jusqu'en 1618
Il était d'usage à Dunkerque, de fêter chaque année le renouvellement du Magistrat, le jour de la Saint-Jean-Baptiste par un grand banquet. Contre toute attente, cette année là les Pères Jésuites y furent conviés. Ils acceptèrent, sans toutefois que cette acceptation pût tirer à conséquence pour les années suivantes.
Cette situation dura deux ans.

Dès que les Jésuites prirent possession des locaux. Ils transformèrent la brasserie en chapelle.
Dans leur Chapelle, les Jésuites firent des Conférences qui eurent beaucoup de succès, des sermons, des fêtes de Noël qui attirèrent beaucoup de public, ils donnèrent aussi des représentations où figuraient des tableaux tirés du catéchisme, toutes fêtes sur lesquelles nous reviendrons.
La crise de 1618.
Pendant quatre ans, la résidence fonctionna avec un personnel de quatre religieux.
Le Général avait décidé de la détacher complètement du Collège de Bergues, auquel elle était jusque là rattachée, de façon à ce qu'elle pût avoir ses fonds particuliers.
Ils ouvrirent leur maison d'éducation en 1621, et en peu d'années, leurs écoliers s'étaient tellement multipliés, qu'il leur fallut augmenter le nombre des Pères.
Malgré les avantages que leur fit encore le magistrat, ils se virent, en 1625, sur le point de quitter la ville, mais l'utilité de leur établissement était si évident, que de nouvelles faveurs leur furent faites.
L'article 22 de la capitulation accordée au magistrat de Dunkerque par le duc d'Enghien à la prise de cette place, en Octobre 1646, porta que les Pères de la Société pourraient librement demeurer dans la ville et rester sujets aux supérieurs, recteurs et provinciaux de la province de Flandre
Douze ans après, le vicomte de Turenne ayant, à son tour, assiégé Dunkerque, que les Espagnols avaient repris depuis 1652, le même art. 22 fut reproduit dans la capitulation signée le 23 Juin 1658.
Le collège des Jésuites avait pris toute l'extension que comportait la population, et le zèle des Pères ne se démentait point. Comme moyen attrayant d'émulation, ils faisaient jouer, aux époques des distributions de prix ou des fêtes de l'ordre, des œuvres dramatiques par les jeunes gens confiés à leurs soins. Il fallait que les moyens d'exécution de ces pièces fussent appropriés aux éléments qu'offrait la localité. Or, à Dunkerque, alors, on ne parlait que le flamand, et c'est en cette langue que les œuvres représentées par les élèves des Jésuites étaient composées.
Le 2 Décembre 1662, le roi Louis XIV fit une entrée solennelle à Dunkerque, qu'il venait d'acquérir du roi d'Angleterre. Il entendit, à cette occasion, plusieurs écoliers des Jésuites, représentant les génies de Dunkerque, qui lui récitèrent , une agréable apostrophe en vers, disant les louanges du roi et du dauphin, et invitant le peuple à se réjouir de la présence d'un aussi grand monarque
en date du 4 Août 1666, une maladie pestilentielle régnait à Dunkerque et faisait beaucoup de victimes. Les Pères Jésuites, comme les Récollets, firent alors preuve de dévouement, et se consacrèrent résolument au service des malades.
L'opinion publique a varié beaucoup sur leur compte. D'une part ils ont inspiré l'enthousiasme, de l'autre ils ont provoqué la haine et la persécution; les Dunkerquois, comme la France, comme l'Europe entière, ont éprouvé à leur égard les sentiments les plus contraires.
Le 18 Août 1762, M. Faulconnier, en qualité d'homme du roi, signifia aux Jésuites les arrêts du parlement qui condamnaient leurs doctrines.
Le Père provincial, qui s'était rendu à Dunkerque, supplia les magistrats de vouloir bien rendre au collège de Dunkerque un témoignage favorable, et M. Faulconnier lui-même n'hésita pas à écrire au procureur général que le collège de cette ville, le seul de la Flandre qui fût du ressort du parlement, était composé de dix Jésuites, tant prêtres que frères laïcs, qui depuis leur établissement ne s'étaient occupés que de l'enseignement des humanités et du prêche religieux dans la paroisse.
Le 15 Janvier 1765, on vendit aux enchères publiques les meubles et effets des Jésuites.
L'église resta fermée depuis leur expulsion jusques au 8 Janvier 1764, et qu'on la rouvrit sous le nom d'église Notre-Dame, pour y dire des messes.
Après plusieurs édits qui aggravaient la position des Jésuites, un dernier édit, du 9 Mai 1767, ordonna qu'ils eussent à sortir du royaume sous quinzaine. Cet arrêt fut lu et publié à Dunkerque le 16 Mai.
Les bâtiments des Jésuites qui, après l'expulsion de l'ordre, avaient continué d'être à l'usage du collège communal jusqu'à la révolution (lettres-patentes du roi du 6 Mai 1769), étaient ensuite tombés dans un tel état de délabrement, qu'il fallût les démolir en 1826, et l'on construisit sur leur emplacement un nouveau collège en 1826.
Tout d’abord appelé le grand collège il prit en 1895 la dénomination de collège Jean-Bart.



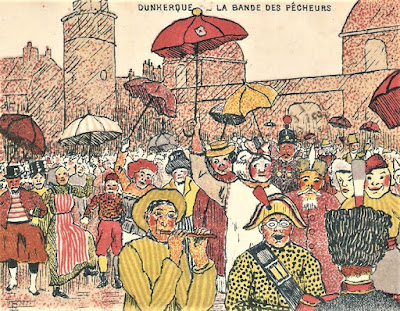
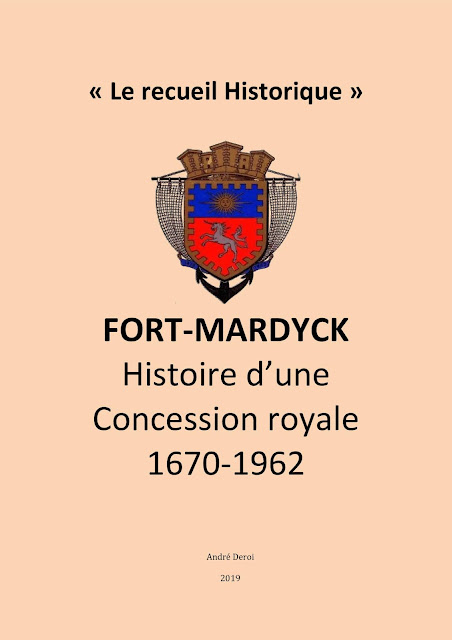





Commentaires