Le-Docteur-Lancry-et-le-jardin-ouvrier.
Médecin des pauvres, il entendait rendre chaque ouvrier propriétaire de son logement et de son coin de terre. Il était notamment fasciné par la particularité de Fort-Mardyck il écrit notamment une notice sur Fort-Mardyck en 1890 .
Avec quelques catholiques progressistes de ses amis, il est à l'origine d'une doctrine de réformation sociale : le terrianisme.
Laquelle, entres autres caractéristiques, prône le retour à la terre, revendique une retraite ouvrière et veut « rendre tout le monde propriétaire ».
Renonçant à s'engager personnellement en politique, il soutient en 1893 l'abbé Jules Lemire, d'Hazebrouck, candidat à la députation, qu'il contribue à faire élire avec un programme terrianiste, dont l'un des articles -et non le moindre- est l'insaisissabilité, l'exemption d'impôts et frais de succession du jardin et de la maison « que l'ouvrier aura acquis par son travail ».
Après l'élection, Félicie Hervieu (1) demande au nouveau parlementaire d'appuyer politiquement son œuvre qu'elle juge proche du terrianisme.
De cet avis, et voyant en Madame Hervieu un précurseur, Lancry et Lemire adoptent alors le concept sedanais (1) que Lancry rebaptisera « jardin ouvrier », c'est-à-dire « un jardin à tout ouvrier ». La nouvelle appellation n'est pas anodine, car derrière ce néologisme on retrouve la grande aspiration des Terrianistes : transformer « le prolétaire en propriétaire foncier ».
Le docteur Lancry veut que sur sa parcelle de terre le travailleur bâtisse sa maison ; le jardin induit un logement. En modifiant le nom de l’œuvre il en change donc aussi le sens : d'une œuvre d'assistance, il fait un projet politique.
Le Dr Gustave Lancry, était notamment fasciné par la particularité de Fort-Mardyck . C’est d’ailleurs sous sa plume qu’apparaît pour la première fois le terme « jardin ouvrier », dans la revue Démocratie chrétienne en octobre 1895.
Voilà, très brièvement, la genèse des jardins ouvriers, que Lancry et Lemire ne cesseront de promouvoir : l'un dans les journaux, l'autre à l'Assemblée nationale.
Le 21 octobre 1896, ils participent à la fondation de la Ligue française du Coin de Terre et le Foyer, dont le député Lemire sera le premier président et dont le but est de procurer aux prolétaires un terrain, de les aider à y construire une habitation, et d'obtenir des pouvoirs publics l'insaisissabilité de l'ensemble. Reconnue d'utilité publique par décret présidentiel en 1909.
À partir de la loi du 26 juillet 1952, on l'appellera officiellement jardin familial, moins connoté socialement. Mais cette autre dénomination ne gomme pas la première, et l'on continuera de parler indifféremment de jardin ouvrier ou de jardin familial.
La Société des Jardins ouvriers se propose d'instaurer normalement la famille, de mettre à la disposition des familles ouvrières, et surtout des familles nombreuses des grands centres des jardins d'une certaine étendue, et cela gratuitement ou moyennant une légère redevance; en payant plus cher, l'ouvrier peut même s'assurer la pleine propriété de son jardin.
Ces jardins sont des terrains loués ou achetés dans les quartiers excentriques ou dans les faubourgs des grandes villes, terrains inoccupés, terrains à bâtir que l'on divise en carrés et qu'on met à la disposition des familles pour être cultivés. Parfois même l'œuvre facilite aux intéressés l'achat des semences, de l'engrais, des instruments de jardinage nécessaires.






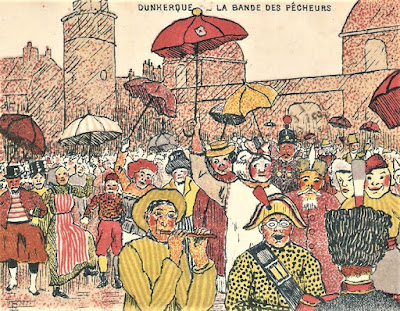
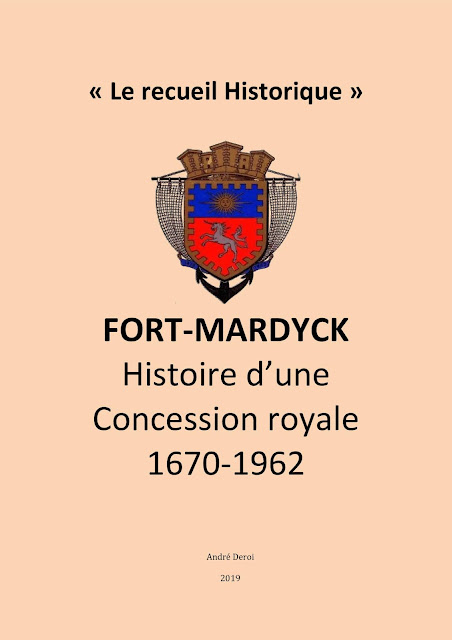





Commentaires