Georges Lesieur
Georges Lesieur.
Georges Lesieur (né le 30 novembre 1848 à Paris, où il décéda le 22 novembre 1931) décida, à l'âge de 60 ans, d'entreprendre son grand projet d'édifier un "groupe d'huilerie" à double activités d'huilier et de pétrolier.
Georges Lesieur achète 100 hectares de terrains, à la limite des communes de Coudekerque et de Capelle, en bordure du canal de Bourbourg. Là va s'édifier la société Lesieur dans la banlieue immédiate du port de Dunkerque, depuis 1908.
Dunkerque est, dès les premières années du 20e siècle, le troisième port arachidier français derrière Marseille et Bordeaux. Nul doute que ce dernier aspect fut l'un des éléments déterminants qui poussèrent Georges Lesieur à installer une huilerie à Dunkerque.
Ce rôle déterminant de la famille apparaît d'abord avec Georges Lesieur qui s'entoure dès le début de ses trois fils, Maurice, Paul et Henri, dont l'avenir se trouvait ainsi assuré et qui constituèrent une véritable fratrie au sein de laquelle s'opérait une certaine répartition des tâches.
L'une des caractéristiques les plus frappantes est le degré élevé de formation.
Maurice, fils aîné de Georges Lesieur, âgé de vingt-cinq ans en 1908, jeune ingénieur de l'École Centrale, il supervisera, entre autres tâches, les aspects techniques de l'activité pétrolière de son père.
Paul Lesieur, deuxième fils de Georges Lesieur, âgé à l'époque de vingt-trois ans ; tout juste diplômé d'HEC, il sera plus particulièrement chargé - sous l'autorité de son père – de superviser l'achat des graines oléagineuses.
Et enfin, son fils cadet Henri, à l'époque âgé de vingt ans.
Le haut degré de formation apparaît aussi avec les gendres du fondateur, plus particulièrement avec Jacques Lemaigre Dubreuil qui joua un rôle essentiel dans la fondation des établissements africains.
Elle se poursuit sous Paul Lesieur, deuxième fils et successeur de Georges Lesieur, puis sous Michel Lesieur, qui engagèrent, l'un et l'autre, l'entreprise dans des voies nouvelles. Véritable «colonne vertébrale» de l'entreprise, la famille fondatrice permit en outre la diffusion d'un esprit maison très particulier, fortement teinté, dans le domaine social, de w paternalisme, et qui contribua à préserver la cohérence de l'entreprise jusque tard dans les années 1960.
Georges Lesieur a transféré son savoir, son savoir-faire et la puissance de son réseau de relations, formé pendant plus de quarante ans d'expérience dans la direction d'une autre entreprise, Desmarais Frères(1).
Le fondateur de la société Lesieur est originaire d'une famille de la petite bourgeoisie, propriétaire de terres et cultivateurs dans la commune de Septeuil (région parisienne). Autodidacte, il doit sans doute l'essentiel de sa réussite à sa volonté propre et à ses mérites.
Il entra dans la vie active en 1863, âgé de quinze ans, comme employé de commerce chez Desmarais Frères.
Pendant toutes les années de croissance de la firme Desmarais, Georges Lesieur avait connu une carrière remarquable. Il gravit peu à peu les échelons hiérarchiques de la société jusqu'à accéder, au tournant des années 1870-1880, aux fonctions de fondé de pouvoirs chez Desmarais Frères.
Il vit ses compétences professionnelles reconnues par ses pairs qui l'accueillirent, en 1895, à la Chambre de commerce de Paris et au sein d'un grand nombre de comités et de conseils d’administration de sociétés. Entre 1901 et 1903, il est trésorier de la Chambre de commerce de Paris, de 1903 à 1904, vice-président et président de 1905 à 1907.
Ce qui lui ouvrit de nombreuses portes dans le monde des affaires, de l'entreprise, de la vie culturelle et du monde de l'éducation. Et surtout révèle un homme très au fait des questions liées au commerce international - douanes, exportations, achats en temps de guerre…- et, notamment, au négoce des graines oléagineuses ; mais c’est aussi un homme sensibilisé aux questions touchant le bien public sa nomination au comité consultatif de l'hygiène publique en France en témoigne et sans doute pas indifférent aux questions culturelles, comme le montre sa présence au sein du conseil de perfectionnement des langues orientales vivantes.
Surtout, ces nominations suggèrent l'existence, d'un réseau de relations et d'amitiés sans doute très étendu dans tout ce que Paris compte alors de «décideurs» publics et privés, financiers et industriels.
Les différentes fonctions occupées par Georges Lesieur lui permirent de voyager aux États-Unis, d’où la société Desmarais importe une partie de son pétrole. Au cours de ses voyages, il visite des entreprises appartenant au secteur pétrolier et huilier. Ces voyages, peut-être le sensibilisèrent aux idées d'organisation industrielle, déjà très répandues outre-Atlantique.
Lesieur faisait partie de ces quelques industriels (Citroën, Renault, Michelin) qui étaient allés voir aux États-Unis les nouvelles organisations industrielles. Homme de relations mais aussi véritable industriel aux compétences très étendues, tel nous apparaît en définitive Georges Lesieur.
Connaissant bien les métiers de l'huile et du pétrole, assuré d'y trouver de multiples appuis, c'est tout naturellement vers eux qu'il décide, au printemps 1908, de se tourner.
L’entreprise Lesieur sera rapidement très florissante. Le niveau de vie des populations européennes s’améliorant peu à peu, la consommation de corps gras augmente. Il fut également à l’origine d’innovations dans le commerce de l’huile alimentaire puisqu’il fut le premier (en 1924) à commercialiser l’huile en bouteille et sous sa propre marque. Il dépose en 1923 la marque «Lesieur» devant le tribunal de commerce de Paris. Jusqu’alors l’huile alimentaire était vendue en tonneaux aux épiciers qui la revendaient sans marque aux particuliers, lesquels apportaient leur récipient pour obtenir la quantité d’huile désirée.
Georges s'est entouré de ces trois fils mais aussi et surtout de trois de ses anciens collaborateurs de chez Desmarais : Victor Cladière, Henri Doyen et Joseph Flipo.
Joseph Flipo, titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste acquit à l'Institut catholique des arts et métiers de Lille (ICAM) et ayant fait jusqu'ici carrière chez Desmarais. Il sera chargé, dès l'origine, à l’âge de 34 ans, en collaboration avec Georges Lesieur, de concevoir et de réaliser l'usine Lesieur de Coudekerque. Un tel rôle à un tel âge en dit long sur les liens qui l'unissent à Georges Lesieur et sur la confiance que celui-ci lui accorde mais aussi sur son degré de formation très élevé.
Victor Cladière, diplômé d'HEC, ancien collaborateur de Georges Lesieur chez Desmarais, devait faire office dès le début de directeur commercial, ses attributions s'étendant essentiellement à la distribution des produits Lesieur.
Et enfin, Henri Doyen, venu lui aussi de chez Desmarais, juriste de formation, devait être plus particulièrement chargé des questions administratives, c'est-à-dire du personnel et de la comptabilité. Notons que Georges Lesieur s’entoure d’une équipe d’hommes d’expérience où s’exerçaient des compétences scientifiques et techniques de haut niveau et complémentaires (ingénieur, commercial et juriste).
A l’origine, le motif de sa création d’entreprise est d’assurer l’avenir de ses trois fils (raison familiale). Ce qui explique le caractère familial très soudé de son entreprise pendant de longues années. G. Lesieur était ouvert au monde extérieur et il a mis à profit ses voyages d’observation aux États-Unis pour une meilleure productivité, par la mise en application d’une nouvelle organisation managériale au sein de son équipe dirigeante. Celle-ci, structurée de façon rationnelle, était composée de postes bien différenciés et de tâches spécialisées. G. Lesieur possède également un capital-relations important. Il bénéficie d’un réseau relationnel dense parmi les milieux professionnels et institutionnels. Son capital financier l’est aussi : l'entreprise familiale Lesieur a été constituée par l'apport personnel de Georges Lesieur. Soulignons que les biens industriels et immobiliers et le patrimoine familial étaient confondus. C’est la preuve que G. Lesieur est un entrepreneur et non un manager
(1)d'abord dans le domaine des huiles végétales, elle devient finalement un des principaux pétroliers français de son temps. Après la Première Guerre mondiale, elle devient le premier acti
onnaire privé de la Compagnie française des pétroles (CFP), qui donnera naissance à Total.







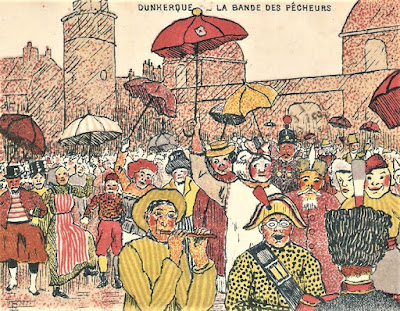
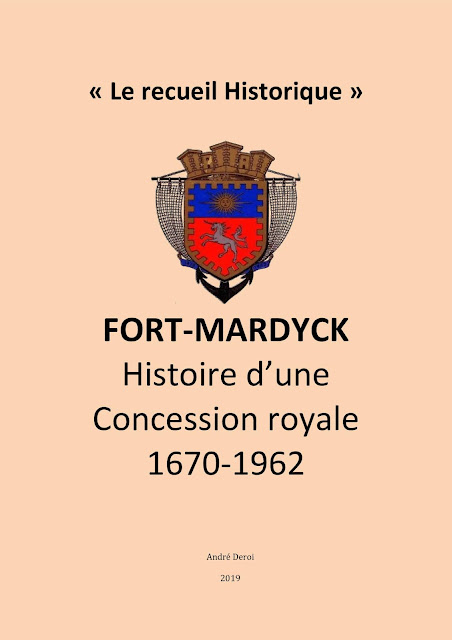





Commentaires