Dunkerque les Carmes 1653/1793
Les Carmes auraient été admis à Dunkerque en 1563.
Lors de leur admission à Dunkerque, les Carmes de Gand achetèrent un terrain en Basse-Ville,
entre le canal de Bergues et le canal des Moëres.
La maison ne devait recevoir que six religieux, et il était expressément convenu qu'ils ne seraient jamais à la charge de la ville.
De 1663 à 1666 une partie de leur jardin fut mise en réquisition. On y éleva des cellules pour les soldats atteints d'une maladie contagieuse.
En 1673, comme leur terrain était compris dans les fortifications de l'ouvrage à couronne, ils durent songer à se transférer ailleurs.
Ils achetèrent de leurs deniers et de ceux de leurs amis un jardin appartenant à la confrérie St-Georges
En 1682 , leur provincial les autorisait à emprunter pour subvenir aux frais de bâtisse .
Une difficulté qu'on leur suscita les contraignit de faire un mémoire justificatif. Le magistrat crut y trouver des passages injurieux pour le corps des échevins; le prieur dut comparaître devant l'assemblée et protester de ses bonnes intentions en interprétant les paroles du procureur qui avait rédigé le mémoire (8 Décembre 1694) .
En 1697, eut lieu dans leur chapelle provisoire la translation solennelle des reliques de saint Joseph.
En 1700 (4 Juin), l'échevinage fournissait aux religieux de quoi pour aider à bâtir leur église.
En 1746, ils prirent envers lui l'obligation de prêcher en flamand et en français à des jours marqués. La bonne intelligence paraissait assurée pour longtemps.
Le mauvais esprit qui animait Choiseul et son administration contre les couvents se manifesta de bonne heure contre les Carmes.
Dès 1770, comme on cherchait à les évincer à leur tour, l'échevinage leur délivra un certificat attestant que: les Pères Carmes sont très utiles et même nécessaires à la population.... Ils donnent les secours spirituels à la population.... entendent la confession en flamand, en français, en anglais et autres nations....
Pendant quelque temps il fut sursis aux mesures hostiles que l'impatience des novateurs voulait réaliser.
Cependant en 1778 le bourgmestre interdit la prédication à un Père Carme...
A Dunkerque la question des eaux potables avait toujours occupé nos édiles.
Des citernes avaient été construites sur différents points de la ville. Un réservoir de la contenance de quinze cents tonnes fut installé, en 1779, dans le jardin de nos Pères, comme récipient des eaux qui, en temps de pluie, s'écoulaient abondamment de leurs vastes bâtiments. En acceptant cette servitude, après l'avoir réglementée, les Carmes témoignaient de leur reconnaissance pour le magistrat et de leur bienveillance pour les habitants. Ils ne devaient pas tarder à recevoir des uns et des autres des marques de sympathie, et la récompense des bons services rendus à la population entière.
A la vue de ce mauvais vouloir chaque jour plus marqué, le provincial rappela à Gand ses religieux et n'en laissa que deux à Dunkerque (1781).
Le magistrat mécontent lui écrivit immédiatement que cette mesure empêchait les Carmes restants de remplir l'obligation contractée par eux en 1746 de prêcher la station flamande et française à la paroisse et de confesser comme ils avaient coutume de le faire.... Il le menaçait, en cas de persistance, de retirer l'autorisation de faire la quête, etc.
Par rancune sans doute, l'administration des domaines les rançonna; pour une légère omission de forme, on leur imposa une amende Ils demandèrent l'autorisation d'emprunter (1784) pour solder cette dette inopinée. Ce qui leur fut accordé (28 Septembre).
En 1790, la visite domiciliaire faite par les deux commissaires de la municipalité constata chez les Carmes 28 religieux, dont 25 prêtres, parmi lesquels douze consacrés uniquement au confessionnal, pouvaient à peine suffire à ce devoir. Ils ne firent aucune résistance; ils n'élevèrent pas même une réclamation; ils déclarèrent leurs propriétés, consistant en leur couvent et quatre maisons attenantes, une bibliothèque de 1700 volumes environ, les meubles, ustensiles nécessaires à la vie ordinaire, pas d'argenterie, sauf celle qu'exige le service divin...
Toutefois, pour détourner, s'il était possible, la spoliation dont ils allaient être victimes, suivant le conseil de quelques amis, ils essayèrent de faire valoir qu'ils étaient étrangers; que dans les visites de leurs supérieurs ils étaient nommés Belges, Franco-Belges; que leur propriété était acquise de deniers venant de la Belgique, etc.
Le 28 Juin, une affiche apposée à leur porte leur fit savoir qu'on les considérait comme Français, et que par suite le personnel de leur couvent allait être transféré à Estaires, pour être incorporé aux Récollets...
En Août 1791, la municipalité, désireuse de conserver à la ville ces bons religieux, déclarait que l'établissement des Carmes devait être réputé fait par des étrangers, et qu'aux termes de la loi, ils devaient continuer à jouir des biens par eux acquis de leurs deniers et ceux de leur nation, comme par le passé...
Néanmoins, le 26 avril 1792, deux officiers municipaux, accompagnés du procureur de la commune et du commis greffier juré, procédèrent à la fermeture de l'église et à un nouvel inventaire des meubles.
Le 27 Septembre 1793, on n'en procéda pas moins à la vente des meubles des Carmes français.
En 1700 (4 Juin), l'échevinage fournissait aux religieux de quoi pour aider à bâtir leur église.
En 1746, ils prirent envers lui l'obligation de prêcher en flamand et en français à des jours marqués. La bonne intelligence paraissait assurée pour longtemps.
Le mauvais esprit qui animait Choiseul et son administration contre les couvents se manifesta de bonne heure contre les Carmes.
Dès 1770, comme on cherchait à les évincer à leur tour, l'échevinage leur délivra un certificat attestant que: les Pères Carmes sont très utiles et même nécessaires à la population.... Ils donnent les secours spirituels à la population.... entendent la confession en flamand, en français, en anglais et autres nations....
Pendant quelque temps il fut sursis aux mesures hostiles que l'impatience des novateurs voulait réaliser.
Cependant en 1778 le bourgmestre interdit la prédication à un Père Carme...
A Dunkerque la question des eaux potables avait toujours occupé nos édiles.
Des citernes avaient été construites sur différents points de la ville. Un réservoir de la contenance de quinze cents tonnes fut installé, en 1779, dans le jardin de nos Pères, comme récipient des eaux qui, en temps de pluie, s'écoulaient abondamment de leurs vastes bâtiments. En acceptant cette servitude, après l'avoir réglementée, les Carmes témoignaient de leur reconnaissance pour le magistrat et de leur bienveillance pour les habitants. Ils ne devaient pas tarder à recevoir des uns et des autres des marques de sympathie, et la récompense des bons services rendus à la population entière.
A la vue de ce mauvais vouloir chaque jour plus marqué, le provincial rappela à Gand ses religieux et n'en laissa que deux à Dunkerque (1781).
Le magistrat mécontent lui écrivit immédiatement que cette mesure empêchait les Carmes restants de remplir l'obligation contractée par eux en 1746 de prêcher la station flamande et française à la paroisse et de confesser comme ils avaient coutume de le faire.... Il le menaçait, en cas de persistance, de retirer l'autorisation de faire la quête, etc.
Par rancune sans doute, l'administration des domaines les rançonna; pour une légère omission de forme, on leur imposa une amende Ils demandèrent l'autorisation d'emprunter (1784) pour solder cette dette inopinée. Ce qui leur fut accordé (28 Septembre).
En 1790, la visite domiciliaire faite par les deux commissaires de la municipalité constata chez les Carmes 28 religieux, dont 25 prêtres, parmi lesquels douze consacrés uniquement au confessionnal, pouvaient à peine suffire à ce devoir. Ils ne firent aucune résistance; ils n'élevèrent pas même une réclamation; ils déclarèrent leurs propriétés, consistant en leur couvent et quatre maisons attenantes, une bibliothèque de 1700 volumes environ, les meubles, ustensiles nécessaires à la vie ordinaire, pas d'argenterie, sauf celle qu'exige le service divin...
Toutefois, pour détourner, s'il était possible, la spoliation dont ils allaient être victimes, suivant le conseil de quelques amis, ils essayèrent de faire valoir qu'ils étaient étrangers; que dans les visites de leurs supérieurs ils étaient nommés Belges, Franco-Belges; que leur propriété était acquise de deniers venant de la Belgique, etc.
Le 28 Juin, une affiche apposée à leur porte leur fit savoir qu'on les considérait comme Français, et que par suite le personnel de leur couvent allait être transféré à Estaires, pour être incorporé aux Récollets...
En Août 1791, la municipalité, désireuse de conserver à la ville ces bons religieux, déclarait que l'établissement des Carmes devait être réputé fait par des étrangers, et qu'aux termes de la loi, ils devaient continuer à jouir des biens par eux acquis de leurs deniers et ceux de leur nation, comme par le passé...
Néanmoins, le 26 avril 1792, deux officiers municipaux, accompagnés du procureur de la commune et du commis greffier juré, procédèrent à la fermeture de l'église et à un nouvel inventaire des meubles.
Le 27 Septembre 1793, on n'en procéda pas moins à la vente des meubles des Carmes français.





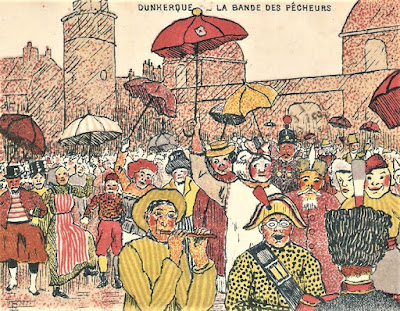
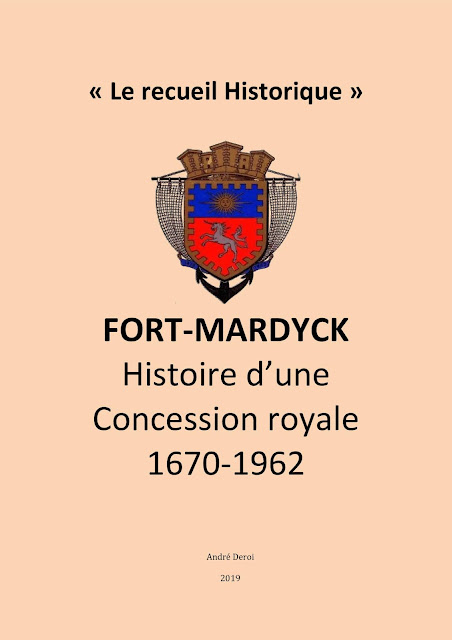





Commentaires