Dunkerque Les Cordeliers, Récollets. 1436/1792
Les Récollets sont des Religieux franciscains, une des branches nombreuses du grand arbre de vie religieuse plante au début du XIIIe siècle par François d'Assise le Séraphique et qui devait très vite rayonner sur toute l'Europe occidentale par l’un ou l'autre de ses rameaux : Franciscains du 1er ordre, Cordeliers, Capucins, Tiers ordre, Religieux de la stricte observance, etc.En 1436 les Cordeliers à la langue manche, adressèrent au magistrat une requête aux fins d'établir un couvent à Dunkerque.
le pape Eugène signa la bulle d'institution des Récollets de Dunkerque.
Deux ans après Guillaume Schrimeverker et Isebrand son fils gratifièrent les religieux de St-François d'un terrain sur le bord de la mer, ou plutôt de l'arrière-port de Dunkerque.
En 1621 ils prirent le nom de Récollets, et dédièrent leur église à Sainte Marie l'Egyptienne dont ils possédaient la, tête.
Pendant la domination anglaise, les Récollets furent traités avec une prédilection toute particulière. Les distributions de vivres étaient plus fréquentes, plus considérables.
Sous la domination française, Louis XIV eut à se plaindre de l'opposition de ces religieux qui relevaient des Evêques flamands et voulut leur substituer des religieux français. Cette mesure fut rapportée en 1666.
Cette même année la peste éclata à Dunkerque et les pères se dévouèrent près des nombreuses victimes. Enfin en 1668 Louis XIV fait revenir des religieux français. Leur église servit de sépulture à de nombreux bourgeois et notamment aux grands baillis héréditaires Faulconnier.
Cependant en 1771 l’Église, atteinte de vétusté, menaçait de s'écrouler. Après une visite des échevins l'accès en fut interdit au public et on procéda à sa démolition.
En 1772 commença la construction. La première pierre fut posée par l'évêque d'Ypres Mgr de Wavrans et le commandant de la place M. de Chaulieu. L'édifice, possédait alors deux nefs, mais l'entrée se trouvait du côté de la Panne, ruisseau qui a donné son nom à la rue voisine.
L'église était ouverte au public six ans après, le 1er octobre 1778 par le curé de St-Eloi ; elle était, comme la précédente, dédiée à Ste-Marie l'Egyptienne;
En 1789 la Chapelle sert aux assemblées primaires.
En 1790 (22 Mai), effrayés des bruits qui avaient cours et qui apportaient à Dunkerque le récit des sévices dont les religieux étaient l'objet en tant de localités, les Pères se proposaient de se retirer dans leur maison de St-Omer.
le 5 mai 1791, les Récollets sont mis en demeure de quitter leur couvent. Malgré l'intervention du curé Schelle, et le bon vouloir de la municipalité il faut appliquer le décret.
Le 14 avril 1792 l'ordre vient du Directoire du département. il faut s'y conformer. Les vingt-trois religieux quittent leur couvent sur lequel les scellés sont apposés.
Le 7 décembre les officiers municipaux firent l'inventaire de leurs biens.
Ainsi fut liquidée la communauté des Récollets de Dunkerque.
Depuis lors, les bâtiments du couvent et de l'église restèrent abandonnés. Ils servirent temporairement d'hôpital militaire; et, en 1804 l'église et les cloîtres furent réintégrés au culte. L'église fut consacrée sous le vocable de Saint-Jean-Baptiste, dont la fête se célèbre le 24 juin, jour de la fête locale, dite la Kermesse de Dunkerque. Elle devint le siège paroissial du canton ouest de la ville.
En 1945, après les destructions de la Deuxième Guerre mondiale, l’ancienne chapelle des Récollets, n'est pas rouverte au culte.
En 1948, une église Sainte Jeanne-d'Arc, en baraquement au quartier des Glacis, dessert une nouvelle paroisse provisoire.
Bien que partiellement détruite, l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste est totalement démolie en 1957, pour s'adapter aux plans d'urbanisme de Théo Leveau.
En 1958, une ordonnance du cardinal Liénart, évêque de Lille, érige la paroisse Saint-Jean-Baptiste suite à la destruction de l'ancienne église.
Le nouvel emplacement est choisi en accord avec l'évêché et la commune, au centre du quartier HLM des Glacis.



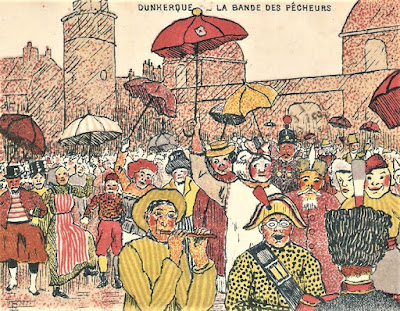
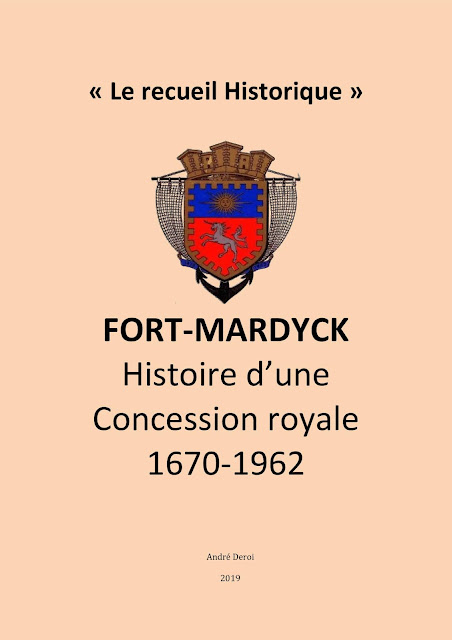





Commentaires